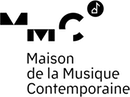Séminaire du Cdmc 2003-2004 : La musique au XXe siècle : l'hypothèse de la continuité

sous la direction de Martin Kaltenecker
La description et la perception de la musique contemporaine sont encore souvent tributaires de l'idée assumée ou sous-jacente de rupture, d'avancée, de coupure radicale, et ce jusque dans les refus mêmes, souvent polémiques, qui avaient accompagné dans les années 1980 le prétendu post-modernisme, déclaré ou ressenti comme dépassement d'une idéologie de l'avant-gardisme, comme rupture avec le "rupturisme".
Il s'agirait au cours de ce séminaire d'interroger (sans la congédier nécessairement), l'idée d'une musique radicalement autre au XXe siècle. Il s'agirait de se souvenir, par exemple, des deux tendances fondamentales de l'historiographie : concevoir l'objet, la période, le réseau étudié comme fondamentalement connaissable, comme offert à l'interrogation (point de départ exprimé par exemple par Jacob Burckhardt au siècle dernier), ou, au contraire, éloignement, voire suspicion méthodique jetée sur la reconstruction de l'objet scruté (par exemple importation de l'ethnographie dans l'étude de la culture de l'Antiquité). Pierre Bourdieu opposait de même, chez les sociologues, l'illusion du "c'est du jamais vu" à celle du "c'est toujours ainsi". Construire le XIXe et le XXe siècle comme un bloc veiné de continuités plus structurantes et décisives que les discontinuités signifie s'inspirer aussi de la pensée de Jacques Rancière, qui distingue (entre autre dans Le Partage du sensible, La Fabrique, 2000) le "régime poétique" au "régime esthétique", situant la véritable rupture à la fin du XVIIIe siècle. Dans le domaine musical, de nombreux champs s'offriraient à la mise à l'épreuve une telle hypothèse :
- Qu'en est-il du recyclage du passé, depuis Mendelssohn, réactualisant Bach et Haendel jusqu'au "supermarché" de l'histoire (Lachenmann) dans lequel tout compositeur peut se servir ; qu'en est-il exactement de la différence de ces actualisations ;
- Qu'en est-il, après la "révolution copernicienne" dans l'interprétation (selon l'expression d'Adorno, qui la situe à l'époque de Beethoven), du rapport au texte écrit, et de la marge où peut se déployer une subjectivité allant éventuellement à l'encontre de la musique ;
- Qu'en est-il du texte comme prétexte, depuis les canevas baroques jusqu'aux partitions pour partie irréalisables des Complexistes ;
- Qu'en est-il des rapports de la musique au politique, de la possibilité d'y déceler des phases, des régimes, des "blancs", des métaphorisations ;
- Qu'en est-il encore des évolutions, par exemple, du poids de la figure de l'auteur dans l'oeuvre ou sa réception, de la situation du concert, des clivages ou tentatives d'approche entre musique savante et musique "populaire", de la prise en compte de la musique par la pensée philosophique bien des catégories et thèmes, nous semble-t-il, seraient ainsi à passer au crible de l'hypothèse de la continuité
le 14 octobre
L'Hypothèse de la continuité
Martin Kaltenecker, musicologue
le 25 novembre
Liturgie du présent et culte du passé : changements de régimes musicaux, le cas de Bach en France
Antoine Hennion
le 9 décembre
Pourquoi musique ? Pourquoi concrète ?
Michel Chion, compositeur
le 27 janvier
La musique, un "objet" troublant pour la philosophie ?
Marie-Louise Mallet, philosophe
le 3 février
René Leibowitz et Theodor W. Adorno, opérateurs historiographiques de la musique du XXe siècle
Esteban Buch (CRAL/EHESS)
le 9 mars
Schoenberg et les fondements gnostiques de la recherche musicale
Hugues Dufourt, compositeur
le 27 avril
Comment développer (et non déconstruire) l’autonomie si contestée de la musique ?
François Nicolas, compositeur
le 11 mai
Dédicaces et préfaces : des lieux d'expression pour les compositeurs à partir du XVIe siècle
Isabelle His (Université de Rennes)